Livre du Bicentenaire (Coiffard, 2008)
L’Anthologie
Auteur : Joël Barreau
Julien Gracq
Louis Poirier, auteur des textes signés du nom de Julien Gracq, fréquenta le lycée, comme élève, de 1921 jusqu’en 1928, puis, comme professeur d’histoire, pendant l’année scolaire 1935-1936.
A ce deuxième séjour son œuvre ne fait qu’une fois allusion, dans La Forme d’une ville, pour nous dire qu’il n’en a gardé aucun souvenir : « Je suis revenu enseigner dans le même lycée où j’avais étudié. Il est singulier qu’aucun souvenir concret n’ait survécu en moi de ce temps de familiarité neuve, qui s’est évaporée sitôt interrompue : je me perdrais aujourd’hui dans les rues du quartier où je vivais cette année-là, je ne reconnaîtrais même pas la maison que j’habitais.»
De fait tous les textes où il évoque le lycée se rapportent exclusivement à ses sept années d’internat. Au reste ces textes sont si nombreux qu’il nous a paru nécessaire, malheureusement, d’y opérer un choix, dont nous espérons qu’il n’est pas trop arbitraire.
Né en 1910 à Saint-Florent-le-Vieil, Louis Poirier, au sortir de l’école primaire publique de sa ville natale, entra comme pensionnaire en octobre 1921 en classe de sixième au Grand Lycée de Nantes, baptisé Lycée Clemenceau deux ans plus tôt. Il y restera jusqu’à l’obtention de la deuxième partie du baccalauréat en 1928.
Une quarantaine d’année plus tard, dans La Forme d’une ville (p. 149-150), il nous présente le bilan de ses années de lycéen :
A distance – à grande distance : il n’a pas fallu moins – le lycée ne m’a pas laissé que de mauvais souvenirs (mais la guerre en laisse aussi quelques bons). J’y ai fait de solides études, et je ne doute guère que le rendement scolaire de cette dure et brutale machine ait été, en fin de compte, pour mes camarades et pour moi, supérieur d’assez loin, à temps égal, à ce qu’il est aujourd’hui. Mais le prix à payer était élevé. Avec le recul d’un demi-siècle, je suis étonné de tout ce que l’institution (où l’internat, cher à la Compagnie de Jésus, continuait à tenir une place centrale, mais dénaturé, réduit au rôle d’un gardiennage disciplinaire, et nullement éducatif) avait conservé de napoléonien, de tout ce qu’elle présentait d’agressivement, de diamétralement opposé au rêve de la société conviviale qui ensorcelle notre temps. Ordre, uniformité, hiérarchie, discipline, restaient les maîtres mots. C’était une institution rude, aux angles vifs et coupants, où tout mouvement spontané avait chance d’être une meurtrissure, où presque toutes les situations étaient d’inconfort, depuis le dortoir glacé jusqu’au linge parcimonieux et au poisson ammoniacal, depuis la bise des corridors jusqu’à l’huile de foie de morue apéritive (administrée, il est vrai, seulement à la demande des familles) analogue, par le supplice de son ingestion, à la purgation au soufre des petits forçats scolaires de Nicholas Nickleby. Elle imposait le sentiment d’une absence de recours, d’une distance entre le bas et le haut presque infranchissable : demander à parler au proviseur aurait semblé à un élève à peu près aussi incongru que, pour une recrue, de demander le rapport du général de division.
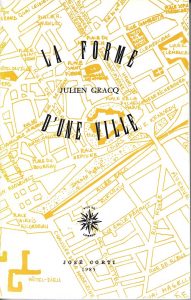
Rappelons qu’à cette époque le régime de l’internat était encore très sévère et fort différent de ce qu’il est devenu de nos jours (La Forme d’une ville, p. 3-4) :
Le régime de l’internat, dans les années vingt de ce siècle, était strict. Aucune sortie, en dehors des vacances, que celles du dimanche ; encore fallait-il qu’un correspondant vînt prendre livraison de nous en personne au parloir, et, en principe, nous y ramener le soir. Je ne sortais qu’une fois par quinzaine ; le reste du temps, je n’apercevais de la ville que la cime des magnolias du Jardin des Plantes, par-dessus le mur de la cour, et la brève échappée sur la façade du musée que nous dévoilait le portail des externes, quand on l’ouvrait pour leur entrée, à huit heures moins cinq et à deux heures moins cinq.
Seuls bénéficiaient d’un régime plus souple les élèves des classes préparatoires, qui, dans le souvenir de Julien Gracq, passaient à ses yeux d’enfant pour des êtres surhumains, membres d’une étrange secte aux rites mystérieux (La Forme d’une ville, p. 177) :
Ces classes de préparation aux concours formaient dans l’internat une caste privilégiée, qui voyait déjà à demi la lumière de la liberté, autorisée qu’elle était à travailler à sa guise pendant les récréations, et à sortir le dimanche sans correspondant. On n’apercevait ses membres distingués que dans les couloirs lointains – discrètement courtois, avec sur eux un reflet déjà isolant de la gloire des grandes écoles – ou bien, sous la blouse blanche maculée d’encre, à travers les fenêtres de leur étude cuirassée de tableaux noirs, le chiffon dans une main, la craie dans l’autre, en méditation tantrique, debout sur un pied, devant leurs rébus algébriques.
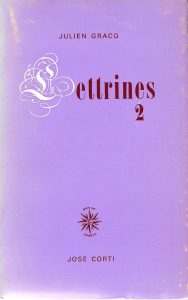
Rien ne suggère mieux peut-être la désolation de la vie d’interne que les promenades scolaires des jeudis et des dimanches évoquées par Julien Gracq avec un certain humour (Lettrines 2, p. 40) :
J’ai retrouvé une à une dans mon souvenir les impasses grises où venaient buter les « promenades » sinistres du jeudi et du dimanche : terrains vagues, dépôts de tramways, banlieues hébétées, verdures lépreuses avec vue d’usines, champs de courses déserts : Pont-du-Cens, La Morrhonière, le Petit-Port, Saint-Joseph-de-Portricq, Route de Vannes, Prairie de Mauves, Pont Rousseau. Lieux sans joie, échouages boueux, minables lisières où nous piétinions en rond l’herbe gelée comme des chevaux à la longe, en attendant l’heure du retour. Toujours, à l’horizon, on avait la Ville, inaccessible et pourtant offerte, amarrée à ses clochers, avec ses grottes, ses cavernes aux trésors, ses merveilles défendues, et de l’autre côté la libre campagne, le vert paradis des vacances, ensoleillé et interdit : nous restions englués à cette frontière morfondue, petits errants vagues battant la semelle et mordus par les engelures, petits singes d’hiver tout envieillis par leurs uniformes nains – séparés, rejetés, échoués.
On comprend que ces conditions de vie des internes aient parfois provoqué des mouvements de révolte, comme le raconte un texte de Préférences (p. 127 à 129) :
Je me souviens, avec une acuité particulière, de l’internat du lycée de Nantes vers les années dix-neuf cent vingt. Un léger vent de folie, à ce qu’il m’a toujours semblé (mais j’étais très jeune) soufflait avec la fin de la guerre sur cette ville curieuse où deux ans auparavant Jacques Vaché venait de se suicider dans les conditions que l’on sait. Sans doute cette température – relevée quelques années après par l’éclat du scandale de « La Close » (sorte de surprise-partie où la cantharide chère à Sade joua un rôle et qui éclaboussa une partie de la haute société nantaise ; un chauffeur de taxi donna l’alarme, voyant des femmes nues traverser la route nationale vers deux heures du matin) ne fut-elle pas sans favoriser l’effervescence étonnante qui se manifestait sous le toit de plomb du quartier des internes. Chaque nuit, sabbat sous les combles, où les évadés du dortoir, apeurés et ravis, accédaient, toutes lumières éteintes, vers minuit, agitant d’inénarrables liquettes, festoyant de boites de sardines et souillant à plaisir la citerne qui alimentait les cuisines, puis s’y baignant – roulement de tam-tam dément des poings sur des cloisons de bois, que j’entends encore se prolonger une nuit, sans arrêt, de dix heures à quatre heures du matin, tandis que le surveillant, les yeux exorbités, arpentait en somnambule, fou de sommeil, l’allée centrale à longues foulées mécaniques, avec une obstination dans la férocité dont le monde adulte n’offrirait que d’assez rares exemples. Verres de lampe écrasés dans le lit dudit, non sans que l’huile « se répandît avec amertume » dans la literie ; machine infernale (une vraie) dans la corbeille à papier du répétiteur, lequel, dompté par le muscadet à huit heures du matin, ronflait en étude, écrasé du sommeil du juste, le chiffon du tableau comme un drapeau en berne dans sa poche, pendant que l’étude entière, debout, beuglait l’Internationale. Suicide d’un pion cocaïnomane, puis suicide par la corde du répétiteur et de sa femme (il y avait de la contagion là-dedans). Le fils d’un riche tanneur, abruti (à seize ans) par l’abus des maisons closes, m’initiait, les paupières lourdes, aux beautés de Rolla. Elèves renvoyés qui giflent l’administration dans les couloirs à grandes claques désinvoltes. Le dimanche, des pensionnaires de sortie « empruntaient » sans autre formalité des véhicules en stationnement le long des trottoirs pour une promenade à la campagne. D’autres, consignés à vie, « partaient » pendant les promenades, un billet de quai en poche, qu’on retrouvait à deux cents kilomètres de là. L’apothéose fut la distribution des prix où, tout le gratin scolaire réuni pour cette festivité au Grand Théâtre, des mains ouvrières cambriolèrent en champ de bataille le bureau du proviseur, cependant que quelques douzaines de lits, projetés du dortoir du second étage, venaient s’écraser sur le pavé de la cour. L’administration finit cette fois par avoir grand’peur.
Plus de trente ans après avoir écrit ce texte, Julien Gracq, revenant sur ces révoltes lycéennes, précise, dans La Forme d’une ville (p. 150), qu’il ne s’agissait nullement d’une insurrection permanente mais de « pulsions anarchiques » qui ne se manifestaient que « par saccades ». Quant à l’administration, ajoute-t-il, elle « ne se laissait pas gagner à la main : je me souviens qu’à la suite de chahuts qui passaient la mesure, une trentaine d’élèves furent rendus d’un coup à leurs familles, aussi désinvoltement que des diplomates soviétiques ».
Au reste, révoltés ou pas, tous les élèves, au témoignage de Julien Gracq, se sentaient fiers d’appartenir au Lycée Clemenceau et regardaient de haut la « clientèle» » des autres établissements, en particulier celle des collèges confessionnels (La Forme d’une ville, p. 172-173) :
Nous nous considérions sans complexe, mes camarades et moi, comme une aristocratie de l’enseignement secondaire, lorgnant de loin, avec quelque malveillance, et sans du tout la fréquenter, ni même la connaître, une aristocratie rivale, que nous jugions de moins bon aloi (même si elle était plus riche) parce que relevant d’un corps enseignant moins pourvu de diplômes et de titres officiels, et au total, à en juger par les résultats scolaires, moins fiable. Quant aux autres établissements d’Etat : l’école professionnelle Livet, les écoles primaires supérieures, les écoles normales, que nous jugions au-dessous de nous, nous les méprisions simplement et parfaitement.
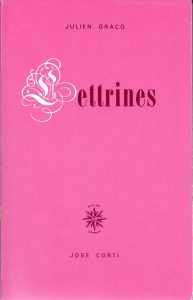
Tel est le tableau d’ensemble que Julien Gracq nous présente du Lycée Clemenceau, tout particulièrement de l’internat dans les années vingt. Tableau d’ensemble sur lequel se détachent en relief quelques souvenirs : par exemple la venue de Clemenceau au lycée, le 27 mai 1922, pour l’inauguration du monument aux morts (Lettrines, p. 84-85) :
Nous formions le carré, assez intimidés, autour de la cour d’honneur. Il vint, vêtu de sombre, en gants gris, noir de plumage au milieu de la volière des uniformes et des robes d’hermine : il avait l’air d’être au milieu de ses laquais. Il fit un discours abrupt, où le ronronnement officiel n’avait pas de place, se compara à ces « vieilles chouettes que les paysans clouent à la porte de leurs granges », puis nous engagea à retrousser nos manches et à faire nos destinées. Et s’en alla tout de go, pendant que la musique du 65e versait quelque héroïsme au cœur des lycéens. Je puis dire que cette tache noire et suprêmement insolente, tapotant ses genoux du bout des doigts pendant que péroraient préfet, recteur et généraux, a dégonflé pour un enfant de douze ans en une minute de son prestige l’officiel aussi brutalement que la pointe d’une épingle dégonfle une baudruche.
Autre souvenir : la découverte des échecs vers l’âge de treize ans grâce à un de ses camarades (Lettrines 2, p. 175-176) :
Un de mes camarades du lycée m’apprit un jour (je devais avoir treize ans) les mouvements des pièces, qu’il se trouvait connaître approximativement par quelque hasard, car il ne jouait jamais. Très approximativement, car pendant assez longtemps j’ignorai les règles du roque et de la prise en passant, et je crus licite d’avancer simultanément d’un pas deux pions encore sur leur case de départ. Je tombai d’abord sous le charme non du jeu, auquel je ne comprenais rien, mais des figurines, qui exercèrent d’emblée sur moi une magie ; il me semblait qu’un pouvoir s’y embusquait, comme dans les arcanes du tarot : il y avait là quelque chose d’un jeu sacré. Je n’avais pas d’échiquier, j’en fabriquai un avec une planchette et de l’encre. Puis je taillai des pièces, grossièrement, avec un couteau. Muni de ce matériel rudimentaire, dans un coin de l’étude, le dimanche, je poussais du bois sans me lasser, à peu près n’importe comment, en compagnie de quelques garnements consignés.
Autre souvenir encore, la découverte de Stendhal, à l’âge de quatorze ans (Lettrines 2, p. 122-123) :
J’avais quatorze ans lorsque je lus dans un manuel scolaire de littérature quelques lignes (il me semble qu’il y en avait sept ou huit, pas davantage) sur Stendhal, dont je ne savais rien, et dont je n’avais jamais entendu le nom. Elles faisaient allusion au jugement de Taine ; il y était question, je m’en souviens, de la précision de la psychologie stendhalienne : ces lignes m’intriguèrent ; le nom du livre, Le Rouge et le Noir, celui de l’auteur aussi, me dépaysait et me plaisait. Il n’y avait guère de moyen pour un pensionnaire du lycée, à cette époque, de se procurer un exemplaire de Stendhal ; une odeur de soufre flottait encore autour de cet écrivain cynique, qui n’avait pas accès aux « bibliothèques de quartier ». Je demandai à mes parents – c’était la première fois que pareille chose m’arrivait – d’acheter le livre ; ils n’en avaient jamais entendu parler et ne firent pas de difficultés ; quelques jours après je l’eus en mains : une édition en deux volumes à couverture verte, qu’il m’arrive encore de feuilleter quelquefois. Les titres des chapitres, et les épigraphes, m’étonnèrent (j’ai toujours eu un faible pour les livres divisés en chapitres, pour les chapitres titrés, et plus encore pour les épigraphes) à peine le livre ouvert ; je ne sais quelle bouffée d’insolence allègre et enragée me sauta à la tête et m’enivra ; en quelques pages, je cédai à une complète fascination. Quand j’eus fini le livre, je le recommençai aussitôt. Puis encore, et encore. Pendant toute mon année de seconde, le livre a couverture verte ne quitta jamais le fond de mon pupitre, en étude ; de cinq heures à sept heures et demie, je travaillais, ou plutôt je retardais mon plaisir ; de sept heures et demie à huit heures, chaque soir, je rouvrais le volume magique et je reprenais place sur le tapis volant ; à la fin de l’année, si on me lisait au hasard une phrase du livre, je pouvais réciter presque sans erreur la demi page qui suivait.
Le Rouge et le Noir a été, beaucoup plus que le surréalisme, ma grande percée à travers le convenu, un convenu qui m’avait trouvé jusque-là parfaitement docile. Chaque soir, en rouvrant la couverture verte, je m’établissais dans une paisible, une tranquille insurrection intellectuelle et affective contre tout ce qui s’était donné à moi pour recommandé, et que je n’avais fait nulle difficulté d’accepter comme tel. Je le lisais contre tout ce qui m’entourait, contre tout ce qu’on m’inculquait, tout comme Julien Sorel avait lu le Mémorial contre la société et contre le credo de Verrières. Mais cette fin de non-recevoir généralisée restait sans violence et sans révolte : elle était congé pris, séparation, froid recul.
Découverte aussi, l’année suivante, en classe de première, de l’art d’écrire et de ses subtilités (En lisant, en écrivant, p. 257) :
Je n’ai jamais perdu le souvenir de ma première classe de français, quand j’entrai en rhétorique. Notre professeur, qui s’appelait Legras, maigre et long comme un échalas, féru de poésie, comme on disait alors, et sachant la faire comprendre, nous donna à décortiquer pendant une bonne demi-heure, pour nous faire les dents, une phrase de La Bruyère qui m’est restée en mémoire : « A mesure que la faveur et les grands biens se retirent d’un homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvraient, et qui y était sans que personne s’en aperçût. » Nous y mordillâmes comme de jeunes chiens sans y mettre à nu, embusquée comme le profil du chasseur des devinettes dans la frondaison des mots, l’image sous-jacente de la marée qui successivement couvre et découvre. Il m’est resté, de ce qui fut alors une petite révélation, le sentiment et le goût de l’image larvée que met en route une seule indication dynamique (« A mesure que… ») sans que rien vienne la préciser ou la cerner si peu que ce soit.
Mais ce que Louis Poirier découvrit de plus important durant ces années d’internat au lycée de Nantes, c’est l’extraordinaire pouvoir de l’imagination, c’est la fascination pour l’ailleurs, c’est, déjà, sa vocation d’écrivain (Lettrines 2, p. 40) :
Nantes. Je feuillette un recueil d’anciennes photographies de la ville, au temps où j’étais pensionnaire au lycée. S’il est une ville dont la forme ait changé plus vite que le cœur d’un mortel… Mais « fourmillante cité, cité pleine de rêves » pour moi, oui, toujours ! J’ai davantage rêvé là, entre onze et dix-huit ans, que dans tout le reste de ma vie : que faire d’une vie commencée de vivre si irrémédiablement sur le mode de l’ailleurs ?
– Sur la vie et l’œuvre de Julien Gracq, voir dans « Julien / Biographies » la notice biographique qui lui est consacrée.
