Livre du Bicentenaire (Coiffard, 2008)
L’Anthologie
Auteur : Joël Barreau
Jean Sarment
L’écrivain Jean Sarment (Jean Bellemère pour l’état civil) est né en 1897 à Nantes. Au sortir du Petit Lycée (l’actuel Lycée Jules Verne), il entra au Grand Lycée en classe de troisième en octobre 1910. Il y poursuivit sa scolarité comme externe jusqu’au printemps de l’année 1914, où, étant en classe de philosophie, il abandonna ses études, malgré ses brillants résultats, pour « monter à Paris » faire du théâtre. Acteur talentueux, auteur dramatique à succès de l’entre-deux-guerres (As-tu du cœur ?, Léopold le bien-aimé, Le plancher des vaches…), il écrivit une pièce Le Discours des prix, créée en 1934 à Paris, dans laquelle il met en scène des élèves, des enseignants et le proviseur du lycée de Rocroy-le-Petit, ville fictive qui – bien des passages du texte le prouvent – correspond à Nantes. Cette pièce est en fait d’un intérêt médiocre et, à elle seule, ne justifierait pas la présence de son auteur dans cette anthologie. En revanche, le roman Jean-Jacques de Nantes, sa première œuvre publiée (en 1922), et surtout Cavalcadour, une assez nostalgique biographie légèrement romancée, éditée seulement en 1977, un an après sa mort, évoquent de façon vivante le Grand Lycée à la veille de la première guerre mondiale.
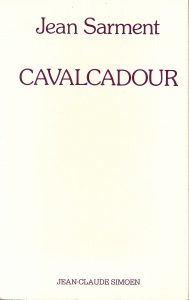
Voici par exemple comment Jean Sarment nous raconte un cours de dessin en classe de troisième. Le « sujet » proposé aux élèves par Monsieur Caussin (appelé ici monsieur Cochin) est un plâtre figurant le pied, plus grand que nature, de l’Empereur Auguste (Cavalcadour, p. 377-379) :
Monsieur Cochin, nerveux, saccadé, cambrant sa petite taille, la barbiche sans discipline assortie aux revers de la redingote – craie en poussière, pastel écrasé, pellicules – passe entre les rangées de cartons à dessin.
Il relève une erreur de perspective, d’un trait de fusain reprend un contour, du bout de son pouce spatulé estompe une ombre trop chargée.
« Mais, petit inconséquent, petit écraseur de crayon, une ombre n’est pas une moustache ! Du marbre de Paros, Monsieur Léotard… Que dis-je ? de l’ambre ! Un soupçon d’ombre sur de l’ambre, et vous me sortez la femme à barbe.
Je vous ai choisi un modèle divin – deux heures de retenue à Monsieur Tordu qui s’imagine que je n’ai pas des yeux dans le dos. Un modèle qui réclamerait la génuflexion ! Chut, chut ! La muse m’a guidé dans mon choix !
Ah ! voyons si Monsieur Héon a progressé. Qu’est-ce que c’est que ça ? Que signifie cette ridicule caricature en marge ? Et que vient faire là cet indiscret petit bonhomme binoclé ? Qu’est-ce qu’il a devant lui ? Un plat à barbe ?
– Une cuvette, Monsieur.
– Et qu’est-ce qu’il brandit ? Un poignard ? Un scalpel, hé ? A quoi rime-t-il, votre bonhomme ?
– Il est là pour les soins, Monsieur. Vous nous avez dit de soigner notre sujet.
– Alors ?
– Alors j’ai fait venir le pédicure. J’ai cru bien faire. »
Explosion d’hilarité. Monsieur Cochin reste là bouche ouverte, un grand étonnement un peu peiné dans les yeux.
« Ah oui ? Parce que, selon vous, le sujet est un… Allons, un peu de courage… Un ?
– Un pied, oui, Monsieur. » Et, avec la douceur de la bonne foi devant l’évidence : « C’est visible. »
Monsieur Cochin se dresse, regarde longuement son modèle, dédie au plafond un sourire de fierté, en laissant errer sur sa lèvre grise une pointe grise de langue gourmande.
« Le modèle est incontestablement – aux yeux du vulgaire – un pied. Énorme. Le pied détaché d’une statue qui doit bien atteindre cinq ou six mètres de hauteur. Pied noble d’ailleurs, à la plante en arche de pont qu’un entrelacs de lanières soude à des semelles hautes d’imperator. »
Monsieur Cochin a gagné sa chaire, et se dresse sur son estrade, bras croisés.
« Ce pied a supporté le poids d’Augustus, portant lui-même le poids d’un monde. Ce pied n’est pas un pied, Messieurs, c’est un piédestal. Que personne ne ricane ! Celui qui ricanerait offenserait la Muse !…. Quatre heures de consigne à Monsieur Malabœuf qui vient de l’offenser, avec cette aggravation qu’il l’offense sous roche…. A qui le tour ? »
Impérial, tel Auguste, il claque de ses deux mains à plat son haut pupitre, dont les deux pieds de devant ont été intelligemment posés en porte-à-faux sur deux bouts de craie, au bord de l’estrade. Le meuble bascule dans le vide, éjectant ses tiroirs, emportant sur le plancher une pile de dessins, un lot de bouteilles d’encre de chine, un buste de Cicéron, dans un bruit de catastrophe.
Monsieur Cochin a failli suivre le mouvement. L’habitude de se cambrer en arrière l’a retenu. Bras croisés, il fait face au déchaînement des rires et des fausses consternations.
« Il y aura consigne générale de trois dimanches consécutifs !… (Un temps)… La Muse, vous jugeant à vos valeurs, conseille à mon mépris de dédaigner de la marquer ? Soit, je lui obéirai. Je lui dois bien cela. Vous ne serez même pas punis.
Remettez-moi en place ce pupitre, jeunes vermisseaux. Et éloignez de moi les restes de ce phraseur surestimé – il pointe deux doigts en fourche vers Cicéron décapité – un rhéteur, un politicard !…. L’aile invisible ne l’avait pas touché… Silence ! Taciti laboremus ! La classe continue ! »
Il se mouche, hautain, dressé, petit coq de bruyère déplumé, petit César Auguste à sa manière, sourit aux anges, à la Muse, à l’aile invisible.
« Jeunes sagouins ! Bande de petits benoîts. »
Mais les passages les plus intéressants sont ceux dans lesquels Jean Sarment nous raconte les aventures d’une « bande » de lycéens parmi lesquels, aux côtés de Jean Sarment lui-même, d’Eugène Hublet et de Pierre Bissérié, se trouvait Jacques Vaché, qui, on le sait, par l’influence qu’il exerça sur André Breton, rencontré à Nantes en 1916, est considéré comme l’initiateur du surréalisme.
Voici donc cette « bande » telle que nous la présente Jean Sarment (Eugène Hublet et Jacques Vaché sont ici désignés respectivement par les noms d’Harbonne et de Jacques Bouvier) (Cavalcadour, p. 354-355) :
Ils se groupent pour faire vingt fois le tour de la cour des grands, plantée d’un quadrilatère de tilleuls, ou pour s’asseoir – se « cuter » dit Harbonne, qui a le goût de l’expression forte – en rangée au pied d’un mur par delà lequel montent les cimes des arbres exotiques et le verdoiement du labyrinthe du jardin des plantes, sous un ciel traversé de vols clairs de pigeons.
Ils devisent, discutent, déclament et proclament, récitent des vers, en composent de barbares et de sibyllins, s’enthousiasment pour Nietzsche, parlent de Confucius et de Schopenhauer comme de bons camarades qui n’ont rien à leur cacher, évoquent leur vie de famille, pour s’en gausser en spectateurs allègres et qui ne furent jamais dupes.
En étude, ils vont de l’un à l’autre, graves, en quête de renseignements importants pour leur dissertation ou leur préparation latine, échangeant des billets rédigés selon les règles d’arcanes mystérieuses, et d’un rituel bien à eux.
Ils ont leurs conventions, leur code, leurs accommodements personnels avec la langue française. Leur sens des valeurs et des hiérarchies. Ainsi, ils ont établi un classement social.
En haut, les « Mîmes ». Pourquoi ? Le mot leur plaît. Il évoque la « mystique grandeur du silence qui s’exprime », comme l’a défini Jacques Bouvier.
Au-dessous des « Mîmes », les « Sârs », hommage à Péladan, aux ésotériques Rose Croix, à tout ce qu’on voudra, qu’ils ne cherchent pas à préciser.
Au-dessous : les hommes (homo vulgaris). Au-dessous des hommes, les sous-hommes, au-dessous des sous-hommes, les « surhommes » ; plus bas, en descendant l’échelle, le sous-off, et, au dernier échelon, enfoncé dans la honte et l’ignominie – autre idée délicate de Bouvier – les « générals ». On ne daigne pas utiliser le pluriel convenu. Un général, des générals.
Tout un jeu de classement et de reclassement. Ainsi on a le « Mîme Dostoiewski », le « Sâr Paul Claudel », le « sous-homme Tor Hugo », le « surhomme Sarah Bernhardt », le « sous-off Raymond Poincaré » et le « général Déroulède ».
Cela pour les aînés. En ce qui les touche, ils n’ont pas encore établi entre eux une échelle de distinctions. Ils sont tous « Sârs » pour l’instant. Leurs parents, dans le cas le plus favorable, des « hommes ».
Seul Bouvier s’obstine à demander si l’on ne pourrait pas trouver pour son père colonel une désignation – au-dessous de général – qui ferait de ce petit homme nerveux, autoritaire, très décoré et très vieilli, et très las sans doute, quelque chose comme un « intouchable ».
Tels qu’ils sont, dans la jeune exaltation de s’être rencontrés et de ne pas en revenir, d’avoir chacun découvert les autres et de s’être découverts à travers les autres, ils ont su appeler de l’air frais. A leur usage, pour se recréer dans cet air. Les voici des « nés d’eux-mêmes », des conçus sans obligation de soumission, de reconnaissance.
Au cœur même du lycée, toute occasion, même la plus saugrenue, de manifester ce renouvellement, est bonne.
On secoue un monde de discipline, comme un cocotier. Les classes, les études et les cours sont devenus des terrains de bravade, d’émancipation.
Certains professeurs parfois savent tenir tête avec humour à leurs défis, comme le montre l’épisode suivant mettant en scène le professeur de français de première, Monsieur Chaussade (appelé ici Chandasse) et un des membres de la «bande», Bissérié (le Billenjeu du texte) (Cavalcadour, p. 356) :
Classe de français. On a un peu trituré la Chanson de Roland et le Roman de la Rose. On s’arrête en passant à tels verbes à significations différentes.
« Exemple… exemple….
– Monsieur, interroge Billenjeu, en toute candeur intellectuelle, quel est le sens exact du verbe baiser ? »
Par toute la classe, un gargouillement, un départ d’éructation, comme un accord « plaqué à la diable » sur un harmonium.
Monsieur Chandasse, dit « Couillasse », ajuste ses lunettes et répond de front :
« Baiser, Monsieur… Billenjeu ? Sens premier : toucher des lèvres. On a coutume, en cette région – lui, Monsieur Chandasse est de Cahors – et dans la populace, de l’employer autrement. C’est ainsi que nous entendons dire : « Allons baiser une fillette »…..…
– Oh ! hurle la classe. Aux mœurs ! Aux mœurs !
….. ce qui signifie : allons vider le contenu d’une verrerie, d’un flacon désigné sous le nom de fillette : je baise une fillette de muscadet.
– Oh ! soupire la classe soulagée, séraphique.
– Le verbe baiser, en votre idiome, revêt également un autre sens : prendre sur le fait : « Je comptais passer mon gibier en fraude, le douanier m’a baisé ». Emploi purement local d’un terme. Ai-je répondu à votre question, Messieurs ? Non ? Pas complètement ? Eu égard au sens supplémentaire et abusif que vous donnez à ce verbe, et qui vous fait ricaner en ce moment, vous aurez tous, Messieurs, une retenue de jeudi. Ceux – Monsieur Billenjeu, Monsieur Bouvier, probablement ? Monsieur Cailloux sans doute – qu’une insatiable curiosité d’esprit a incités à nous poser cette question, feront dimanche quatre heures de retenue supplémentaire. Cela dit : baiser, je le répète, signifie strictement « poser les lèvres sur… » Pour ce que vous pensez existe le verbe noble : prendre . On peut également user du verbe coïter. Je continue, Messieurs, en vous invitant au silence. »
Parfois, tout de même, l’humour de Bissérié-Billenjeu a raison de la patience de Monsieur Chaussade-Chandasse (Cavalcadour, p.356-360) :
Monsieur Chandasse, en verve d’heureuses inspirations, a instauré, chaque samedi, une classe de poésie en liberté avec pour chacun récitation « ad libitum ». Peut-être pense-t-il éveiller des curiosités, tâter le pouls des aspirations poétiques d’une bande apathique et chahuteuse.
« Chacun de vous, Messieurs, n’est-ce pas, a appris, court ou long, pour nous le dire délicatement, un poème qui l’a particulièrement frappé ou ému, ou qu’il considère comme une pièce de choix dans notre poésie française. Allons, Messieurs, je vous écoute. Qu’a choisi aujourd’hui Monsieur Pralon ? »
Monsieur Pralon a choisi La Cigale et la Fourmi.
« La Fontaine, Monsieur Pralon, bien entendu ! Mais enfin, dans La Fontaine même… pour un jeune homme de dix-sept ans…
– Dix-huit, Monsieur.
– C’est vrai, vous n’êtes pas en avance… on peut trouver plus exaltant que La Cigale et la Fourmi. Vous ne croyez pas ?
– Ah ! si.
– Alors ? Pourquoi le choix de cette petite pièce ?
– Parce qu’elle est petite et que je la savais.
– Passons…. Monsieur Charrier ? »
Monsieur Charrier apprécie, lui, Les Éléphants de Lecomte de Lisle. Il faut avouer qu’il en fait valoir les alexandrins bronzés avec des grâces de pachyderme.
Monsieur Chandasse passe le tour de Pirot qui a manifesté l’intention de débiter au cours des semaines le Waterloo d’Hugo en petites tranches et qui maintient sa décision.
« Au suivant !… Monsieur Billenjeu ? »
Billenjeu bondit comme la truite vers la mouche, et, d’une seule haleine :
– A ma fille Adèle, de Victor Hugo.
– Ah ! non.
– Ah ! si.
– Vous me l’avez déjà dit quatre fois.
– Je ne connais rien de plus beau qu’ A ma fille Adèle.
– Ainsi, dans cet océan qu’est Hugo, puisque vous vous en tenez à Hugo…
– Pas à Hugo, à ma fille Adèle
– Et, samedi prochain, c’est bien décidé, vous reviendrez avec…
-… ma fille Adèle, forcément.
– Bon ! assez ri. Vous avez le goût de l’humour, paraît-il ? Mais vous resterez sur votre soif, je vous le garantis, et sur votre fille Adèle.
– Oui, Monsieur.
– Asseyez-vous.
– … sur ma fille Adèle, oui, Monsieur. »
La classe exulte, délicieusement épanouie. Trois timorés encroûtés dans leur bonne conduite pincent les lèvres.
Monsieur Chandasse, en long moment, tremble de colère, la bouche s’ouvrant et se fermant sur une audace verbale qu’il voudrait éructer et qu’il retient.
Son regard se pose, triste, las, découragé, vers quelque chose qu’il semble reconnaître et appeler à son secours, ou pour son apaisement, loin, par delà les vitres et le massif de cannas de la cour d’honneur.
« Eh bien, Messieurs, l’expérience a été faite. Et nous ne la renouvellerons pas. Il n’y aura plus de récitation libre. Nous nous en tiendrons au programme. Samedi prochain de deux à quatre heures, nous aborderons Lefranc de Pompignan et l’Abbé Delille. Je n’admettrai jamais que pour faire de leur professeur un objet de risée, une bande d’impertinents au sortir de l’œuf viennent offenser la poésie… J’ai été jeune aussi, Messieurs, mais… »
La voix s’est raffermie et le regard, un long temps, ne quitte plus le point fixe ou mouvant qu’il est seul à voir par delà la cour du lycée.
On entend, souligné d’un long gloussement d’exaltation, le chuchotement endeuillé et lourd d’émotion contenue de Billenjeu.
« Alors, adieu Adèle… Sans rancune. »
Monsieur Chandasse dédaigne d’entendre ; il se mouche lentement.
En hommage à Jacques Vaché, nous lui consacrerons notre dernier extrait de Cavalcadour. Le voici donc, sous le nom de Jacques Bouvier, à un cours d’astronomie de Monsieur Fillâtre (sans doute s’agit-il de Monsieur Villat, professeur d’histoire et de géographie) (Cavalcadour, p. 360-361) :
Bouvier Jacques, dit « James » – il se pique d’anglophilie et se flatte d’attaches britanniques – avait toujours souffert des taches de son de sa carnation et de sa chevelure flamboyante.
Aujourd’hui en parfaite allégresse, il les jetterait en défi au monde entier.
« Mes taches de rousseur, explique-t-il en classe d’astronomie à son voisin, un verre rond plaqué sur l’œil gauche, mes taches de rousseur, dear sir ? Elles font retourner sur moi les petites nurses dans les rues, les préfètes et les femmes d’évêque. Je pense (I think, and if I think I am), je pense que ces taches de rousseur sont ma sauvegarde, et que si ma vénérée mère n’avait pas, en temps utile et en pays anglo-saxon, trompé mon irresponsable père – I whish, I hope – avec quelque baronnet, clergyman ou clown flegmatique, vous me verriez, Monsieur, avec une petite âme pusillanime et cosmétique de général de Division, à rêver Conseil d’État, Cour des Comptes, et fillettes verdissantes sur mes genoux de gélatine, pour mes vieux jours.
Pardon, Monsieur ?… Non, Monsieur Fillâtre, je ne distrais pas mes voisins. J’étais tout à vos observations si intéressantes, suspendu à ces corps célestes, ronds et lumineux.
– De quoi parlais-je, Monsieur Bouvier ?
– Des comètes, Monsieur.
– Non, Monsieur, des nébuleuses !
– J’allais le dire, Monsieur… Des nébuleuses qui sont de petits corps ronds et lumineux.
– Passez donc immédiatement chez Monsieur le Censeur. Vous lui demanderez s’il est un petit corps…
– Rond, certainement. Mais non lumineux. J’y vais de ce pas.
– Consigné dimanche ! Journée entière. Veuillez le noter.
– So do I, Sir. »
En passant, à Patrice, sans baisser le ton, avec un flegme aristocratique que, depuis Byron, ils n’ont peut-être plus là-bas :
« Si le colonel d’artillerie Bouvier te demande dimanche où je suis, tu lui diras que je suis parti m’engager dans une armée étrangère, vraisemblablement dans les Hussards de la mort, à Nuremberg. A cause de la poupée. Because the puffy.
– Je vous signale à l’instant à Monsieur le Proviseur !
– All right. Monsieur le proviseur est un honnête petit surhomme.
– Vous serez chassé du lycée.
– All is well what ends well… Vive la flotte anglaise, Monsieur.
– Prenez la porte !
– Avec plaisir, Monsieur. Je vous la rendrai. »
|
Ajoutons à cette évocation de Jacques Vaché que, quelques années plus tard, en mai 1917, se trouvant sur le front, il découvrit, dans les décombres d’un village détruit par les bombardements, parmi d’autres archives, le texte de l’arrêté du 1er Vendémiaire de l’an XII de la République (24 septembre 1803) créant le lycée de Nantes : curieuse « coïncidence », note-t-il dans la lettre à sa mère où il relate cette découverte, bel exemple, ajouterons-nous, de ce qu’André Breton appellera plus tard « hasard objectif ».
|
Sur la vie et l’œuvre de Jean Sarment, voir la notice biographique qui est consacrée dans « Julien / Biographies » à Jean Bellemère.
